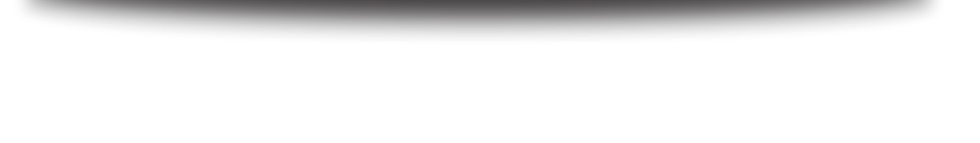Perpétuel renouvellement
Dans une société qui découvre avec enthousiasme les nouvelles distractions théâtrales, musicales et visuelles du cinéma, la Confrérie des Vignerons craint que sa traditionnelle Fête ne sache plus répondre aux attentes de son public. Carlo Hemmerling et Géo H. Blanc, compositeur et auteur vaudois, contribuent largement à sortir la Fête de ses frontières régionales. Une impressionnante palette d'artistes internationaux vient ainsi compléter le dynamisme des figurants locaux, et Hollywood s'installe le temps d'un été sur la place du Marché de Vevey, dans une arène digne des plus grands péplums.
En 1977, la Fête opère un retour aux sources symboliques. Alors que Charles Apothéloz reprend la mise en scène du spectacle une année à peine avant sa célébration, Jean Balissat compose une musique qui soutient admirablement le souhait du librettiste Henri Debluë. Cet auteur vaudois rêvait, après les fastes de l'édition 1955, de ramener la Fête à sa terre d'origine et de recréer un lien avec la tradition chrétienne, telle la symbolique christique de la vigne et du vin qui, jusqu'alors, n'apparaît que très timidement au milieu d'un panthéon de dieux antiques et païens.
En 1999, la Fête des Vignerons est pensée et mise en scène par François Rochaix. Les vignerons sont véritablement placés au centre de la dramaturgie. Une célébration unique, le Couronnement, leur est entièrement consacrée, avant qu'Arlevin, le facétieux vigneron couronné de fiction, ne les représente tous durant les quatorze représentations.
Quelque 200 ans après la première Fête, l'arène contient 16’000 places, 5’000 figurants défilent dans l'arène et il faut près de dix années pour organiser cette célébration hors du commun.



En avant la musique...
La Fête des Vignerons ne cesse de prendre de l'ampleur, tant du point de vue de l'importance de la manifestation que de celui de sa qualité artistique. Au patchwork musical et poétique des premières Fêtes du XIXe siècle, où l'on se contentait de commander un arrangement de paroles de circonstance sur des airs populaires connus, succèdent des Fêtes pour lesquelles des artistes reconnus créent des œuvres originales et cohérentes.
En 1851, François Grast compose la première partition complète qui donne une certaine unité aux textes encore disparates écrits par différents poètes amateurs. Il écrit également la partition de la Fête de 1865. En 1889, la composition de la partition est confiée à Hugo de Senger. Déjà, la Fête tente d'harmoniser culture populaire et élitaire. Elle s'inspire autant de l'opéra que des fêtes alpestres.
En 1905, une œuvre cohérente est pour la première fois réalisée grâce à la collaboration étroite des frères René et Jean Morax et du compositeur Gustave Doret. Ensemble, ils créent un véritable hymne à la terre dont le succès populaire marquera des générations de chanteurs.



De la reprise à la création originale
Les campagnes napoléoniennes et les troubles qui suivent la révolution vaudoise contraignent la Confrérie des Vignerons à attendre 1819 avant de pouvoir organiser une nouvelle Fête des Vignerons et la faire découvrir à la jeune génération. Le cortège se mue alors en un véritable spectacle et réunit 730 figurants.
Les Fêtes ne cessent de se développer au cours du XIXe siècle. Elles profitent en 1833 et 1865 de l'amélioration notable des moyens de transport. Dès 1821, des bateaux à vapeur sillonnent le lac Léman et la gare ferroviaire inaugurée à Vevey en 1861 permet aux spectateurs de la Fête de 1865 d'affluer de toute l'Europe en un temps record.
Le nombre de représentations augmente et 1’200 figurants se pressent dans l'arène accueillant plus de 10’000 personnes. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde et les curieux n’ayant pas pu entrer dans l'enceinte de l'arène, s'installent sur les toits pour assister au spectacle.

La parade se transforme et, en 1797, on érige à Vevey une première estrade de 2'000 places, afin que les spectateurs puissent assister à ce couronnement.
Au fil des ans, la notoriété comme la sophistication des parades ne cessent d'augmenter et le nombre de spectateurs s'accroît. Sous l'impulsion de l'Abbé-Président Louis Levade, le Conseil introduit une nouvelle étape à sa procession: le couronnement.
Sa mise en scène exige un lieu dédié afin que le public puisse assister à ce moment solennel: la vaste place du Marché de la ville est tout indiquée.

Le couronnement
Vers 1770, les mentalités changent et le Conseil de la Confrérie des Vignerons décide de récompenser les meilleurs vignerons-tâcherons afin de les encourager à améliorer leurs cultures. Des prix sont attribués quand les caisses de la société le permettent et les meilleurs vignerons sont placés en tête de la parade, accompagnés de l'Abbé-Président, du Conseil et des membres de la société, et des nombreux figurants, dont les costumes évoquent des figures mythiques et ceux de la culture viticole. Ils sont ensuite invités au traditionnel banquet de la Confrérie.


Informations pratiques
La Fête des Vignerons
Chaussée de la Guinguette 12
1800 Vevey
T +41 21 320 20 19
La semaine prochaine, nous vous ferons découvrir
l'édition 2019 de la Fête des Vignerons.
TEMPS DE LECTURE: 4 MIN



Les origines de la Fête des Vignerons
La Confrérie des Vignerons s'appelle alors "Abbaye de l'Agriculture" ou "Abbaye de Saint-Urbain", du nom de son saint patron, protecteur de la vigne et du vin. À cette époque, elle organise annuellement, tout comme de nombreuses autres sociétés, un cortège appelé parade, pourmenade ou bravade, à travers la ville.
Cette parade fait suite à l'assemblée générale où le travail des vignerons-tâcherons est commenté et critiqué. Elle se clôt par le traditionnel banquet de la société. Drapeau et statuette du saint patron en tête, marmousets (figurines fixées sur des perches, figurant des scènes de la vie quotidienne des vignerons) fièrement exhibés, le cortège quitte alors le parvis de l'église Saint-Martin surplombant la ville et descend jusqu'au bord du lac en sillonnant les étroites ruelles veveysannes.
Au cours du XVIIIe siècle, la promenade à travers la ville s'étoffe. D’abord, les cortèges s’enrichissent de quelques musiciens et chanteuses, puis d’un petit garçon juché sur un tonnelet jouant le rôle de Bacchus (1730), un autre travesti en fille incarnant Cérès, la déesse des blés et des moissons (1747) et enfin de Noé (1765), le premier homme à cultiver la vigne et à s'enivrer.
Alors que la Réforme protestante instaurée par les baillis bernois est encore très sévère et ne tolère que peu de réjouissances communautaires, le cortège de la Confrérie des Vignerons attire de plus en plus de curieux.
Bien plus qu'un spectacle, la Fête des Vignerons est un patrimoine, une tradition vivante qui se transmet de génération en génération depuis le XVIIIe siècle. Cette manifestation hors du commun, alliant tradition populaire et modernité à l'unisson de toute la région veveysanne, est inscrite au Patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis le 1er décembre 2016.
Une situation géographique idéale
Tout commence au XVIIe siècle. À cette époque, Vevey et une partie de ses habitants tirent d'importants revenus de la viticulture et du commerce de transit. Située au carrefour des grandes routes commerciales européennes, la petite ville sert à la fois de dépôt, de port et de marché aux producteurs et marchands venus de toute l'Europe.
Alors que la ville abrite en ses murs de nombreux artisans et commerçants, elle est encerclée par les vignes et près d'un homme sur dix travaille comme vigneron ou tâcheron. La ville vit au rythme des saisons et du calendrier viticole et les salaires sont régulièrement versés en vin, en moût ou en raisin plutôt qu'en monnaie. Bien loin de la cité industrielle du XIXe siècle, Vevey est déjà un centre régional et commercial qui rayonne sur l'arc lémanique.
LA RÉFÉRENCE DU MOIS
La Fête des Vignerons,
au fil du temps





1er WEBMAGAZINE DU VIN, DE LA BIÈRE ET DES SPIRITUEUX





LES + POPULAIRES
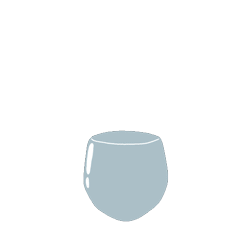

SÉLECTION DU MOMENT
Parcourez les anciennes publications:
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

SERVICES PRO
NOUS PROPOSONS DIFFÉRENTS SERVICES LIÉS
AU MARKETING DU VIN. DÉCOUVREZ-LES DÈS MAINTENANT SUR




SUISSE - FRANCE - BELGIQUE
LUXEMBOURG - QUÉBEC

2015-2023 © Tous droits réservés - RELAIS DU VIN & RELAIS COM Sàrl - Agence de communication globale