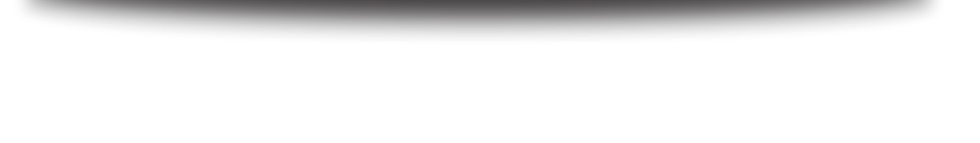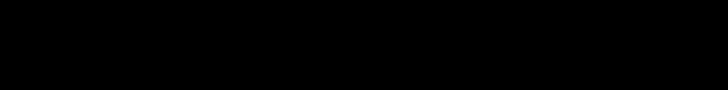
Le pastis dans le jargon
Il existe une multitude de dénominations conférées au pastis. Dans le sud de la France, on demande à déguster un jaune ou un flai pour l’apéro. À Marseille, berceau de la production, on parle de pastaga et on commande un Pastis 51 ou une momie 51 (du nom de petit verre utilisé) pour l’apéritif. Il est aussi courant de demander un Ricard, un fenouil, une pommade ou un flan. Tant de dérivés à la couleur jaunâtre rappelant le pastis. Lorsqu’un pastis est gras, c’est que la quantité d’alcool est trop importante. S’il est très gras, on le prénomme yaourt.
Vous connaissez sans aucun doute la passion de l’auteur, compositeur et interprète français Serge Gainsbourg pour le pastis. Ce dernier a pour coutume de commander un 102, soit un double pastis 51. Il existe également le 153, ou triple pastis 51. Sacrément chargé, nous direz-vous… Selon Fernandel, “le pastis, c’est comme les seins: un, c’est pas assez, et trois, c’est trop.” Mais bon, le plus important reste tout-de-même de protéger la couche d’eau comme a pour coutume de l’affirmer Patrick Sébastien...

L’union fait la force
La bataille fait rage pendant de nombreuses années entre les deux plus célèbres producteurs de boissons alcoolisées anisées de France. C’est finalement en 1975 que fusionnent les sociétés Pernod et Ricard. Aujourd’hui, l’entreprise est spécialisée dans la fabrication et la distribution de vins et spiritueux. Elle est aussi co-leader mondial de son secteur avec les marques Ricard et 51.
Veni, vidi, Vichy
Bonne nouvelle, l’État autorise cette fois-ci la production et la vente de boissons anisées titrant 45° en 1938. Mais malheureusement, la guerre est une nouvelle fois déclarée. Le pastis est interdit en août 1940 par le Régime de Vichy ainsi que toutes les boissons alcoolisées dont le taux est supérieur à 16°. Pernod et Ricard se voient dans l’obligation d’adapter leurs productions pour perdurer. En premier lieu, l’usine Pernod se reconvertit en chocolaterie et l’usine Ricard, à Marseille, produit des jus de fruits, du vermouth mais également des alcools carburants pour le maquis. Une belle manière de résister sous l’Occupation.
Midi moins dix, l’heure du pastis
Le mot “pastis” est désormais dans toutes les têtes et tous les regards sont tournés vers lui. Ce nom provient du mot provençal “patisson” et de l’italien “pasticchio” signifiant tous deux “mélange”. Mélange car un pastis se complète avec cinq à sept volumes d’eau et des glaçons pour être consommé. À la fin des années 30, le pastis est le premier apéritif de France.

En 1945, la guerre continue
La fin de la Seconde Guerre mondiale est actée en 1945, mais pour les producteurs de pastis, une nouvelle commence tout juste: une guerre économique et publicitaire. À la Libération, le nouveau gouvernement mis en place n’autorise que la production d’alcool ne dépassant pas les 40°. Germaine Poinso-Chapuis, Ministre de la Santé de l’époque et surnommée “Chapeau pointu” par Paul Ricard, est la figure de proue de cette décision prise et vécue comme un crèvecœur par les producteurs de pastis. Pour contrer cette décision, une quarantaine de distillateurs décident d'œuvrer clandestinement. En 1951, nouveau coup dur, l’État interdit la publicité sur affiche et par presse des alcools anisés. L’entreprise Pernod décide à ce moment précis de changer son pastis de nom et le renomme “Pernod 51”. Pour contourner le système de répression publicitaire mis en place, Pernod lance une nouvelle forme de propagande en développant des produits dérivés comme des cendriers, des bobs et autres artefacts pour promouvoir sa marque. En 1954, Pernod 51 devient Pastis 51 (nom qui restera le même jusqu’en 1999 avant de devenir simplement “51”).

Midi moins le quart, l’heure du ricard
La concurrence est rude et c’est à ce moment précis qu’entre en scène Paul Ricard en 1920. Jeune commercial âgé de 23 ans seulement, il innove le pastis en incluant de l’anis étoilé, de l’anis vert et de la réglisse, promu par le célébrissime slogan “Ricard, le vrai pastis de Marseille”, au début des années 30. Pour la première fois de l’Histoire, le mot “pastis” apparaît sur une étiquette commerciale. Grâce à l’important réseau de distribution de Paul Ricard, les ventes décollent au grand désarroi de Pernod.
La guerre est déclarée
En 1915, la Première Guerre mondiale fait rage. Pour couronner le tout, la production d’absinthe et de tout alcool au-dessus de 16° est totalement interdite la même année. En réaction, Jules-Félix Pernod, fils d’un ancien et célèbre industriel de l’absinthe, crée et dépose en 1918 la marque “Anis Pernod”, une variante autorisée de l’absinthe. C'est à lui que revient le titre officiel et le mérite d’être l’inventeur du pastis. La boisson est dès lors commercialisée depuis l’usine de Montfavet, près d'Avignon.
Assez indécis, l’État autorise de nouveau en 1920 la production des alcools anisés dont le degré est inférieur à 30°, puis à 40° en 1922. Le pastis connaît alors un incroyable succès populaire, notamment en Provence, et voit sa production déclinée en de nouvelles saveurs.


TEMPS DE LECTURE: 3 MIN + VIDÉO


TOUT SAVOIR SUR
Le pastis, comment protéger
la couche d’eau jaune?
FRANCE · Son aspect jaunâtre et laiteux vous est-il familier? Célèbre boisson fortement alcoolisée du Sud de la France, le pastis sublime nos apéros depuis de nombreuses années. Mais qu’en est-il de son histoire? RELAIS DU VIN & CO vous met l’eau à la bouche sans rire jaune...
Aujourd’hui, celui que l’on nomme principalement “pastis”, est un incontournable de l’apéritif provençal et à plus grande échelle français. Cet alcool aromatisé à l’anis et à la réglisse que l’on complète avec de l’eau et des glaçons est historiquement une variante de l’absinthe à sa conception.





1er WEBMAGAZINE DU VIN, DE LA BIÈRE ET DES SPIRITUEUX





LES + POPULAIRES
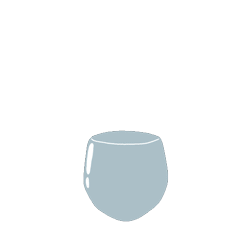
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

SERVICES PRO
NOUS PROPOSONS DIFFÉRENTS SERVICES LIÉS
AU MARKETING DU VIN. DÉCOUVREZ-LES DÈS MAINTENANT SUR




SUISSE - FRANCE - BELGIQUE
LUXEMBOURG - QUÉBEC

2015-2023 © Tous droits réservés - RELAIS DU VIN & RELAIS COM Sàrl - Agence de communication globale